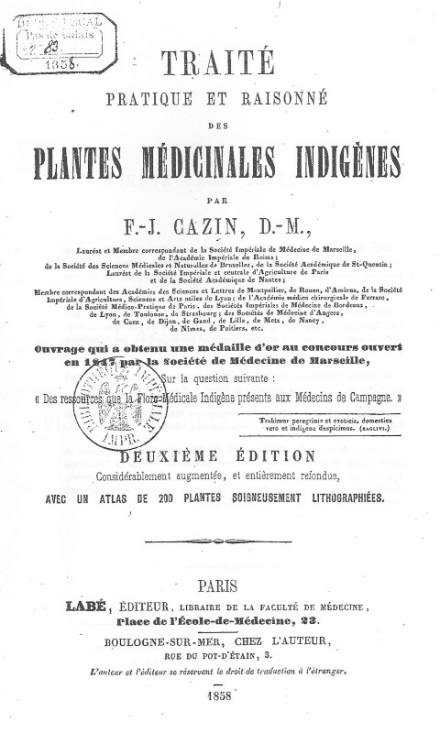Né dans le département du Pas-de-Calais en 1788, François-Joseph Cazin se destine très tôt à la médecine, étant tout d’abord, dès 1804, aide-chirurgien en hôpital militaire, avant de devenir lui-même chirurgien, puis médecin dans la marine. Par la suite, il pratiquera pendant une vingtaine d’années la médecine à Calais, avant qu’un événement inattendu n’imprime de sa patte providentielle la destinée du jeune médecin. En 1832, une épidémie de choléra se déclare dans le nord de la France. Cette maladie, provoquée par la bactérie Vibrio cholerae, touchera bien des parties du monde au gré de vagues successives. En 1832, c’est la deuxième pandémie de choléra (1826-1841) qui s’abat sur la France. Le docteur Cazin met toute son énergie au service de l’éradication de ce fléau, mais il en est lui-même l’une des victimes. C’est cela qui le décide à renoncer à la vie urbaine. Il se rend donc à la campagne, à 50 km de Calais, dans la petite ville de Samer qui l’a vu naître. Il y séjournera jusqu’en 1846. Durant ces presque quinze années, de médecin de ville, Cazin devient médecin de campagne. Et c’est durant ces années que va s’élaborer en son esprit la structure de son œuvre majeure, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes. En 1847, il est récompensé par la Société royale de Médecine de Marseille pour un mémoire qui n’est qu’une ébauche de son traité, lequel paraîtra, dans sa première édition, en 1850. N’ayant, pour ainsi dire, connu que la ville en ce qui concerne ses pratiques médicales, le docteur Cazin est particulièrement frappé par les conditions de vie des habitants des campagnes, considérant, parce que cela lui saute aux yeux, qu’en ville tout est disponible rapidement ou presque, contrairement à cette campagne où contrastent l’opulence de quelques-uns et l’indigence du plus grand nombre. Comparant sa pratique urbaine et celle rurale conditionnée par les plantes qu’il récolte aux alentours, il s’est alors convaincu de la supériorité des espèces végétales indigènes. Dans cette démarche, il a été aidé par la sensibilité qu’il a pu éprouver par rapport à l’empirisme et à la médecine populaire des campagnes, tout en ne tombant jamais dans le piège du remède de charlatan de champ de foire. Plus que tout conscient de la pauvreté dans laquelle vivent la plupart des gens qui l’entourent, il se propose de mettre à l’honneur une médecine bon marché, possible grâce à des moyens simples et peu coûteux, afin que « s’économise l’argent du malade et le temps du médecin » (1), car l’homme de la campagne du XIX ème siècle, « le plus souvent, alors, il souffre sans secours, lutte péniblement, languit ignoré et meurt silencieux et résigné dans une chaumière où le froid, l’humidité, la malpropreté se joignent aux autres causes de destruction ». « J’ai donc renoncé, poursuit-il, dans ma pratique rurale, aux médicaments d’un prix plus ou moins élevé, et aux préparations pharmaceutiques dont le luxe ne peut être payé que par le riche ».
Cazin est l’une de ces icônes propres au XIX ème siècle, symbole de cette dichotomie entre cité et campagne, riches et pauvres, et il se range au côté de ces derniers en homme humaniste qu’il est. Alors que, dans le même temps, pérorent médecins et pharmaciens de ville, qui ne savent que louer les « progrès » de la médecine thérapeutique chimique, exaltant les bienfaits du mercure et de l’antimoine, vouant aux gémonies la thériaque et la conserve de roses. Cazin pointe du doigt les malversations concernant les drogues provenant de pays lointains et qui, une fois parvenues dans les officines, sont de bien moins bonne qualité qu’à leur départ ; non pas que le transport en aura amoindri la valeur thérapeutique, mais surtout parce qu’elles subissent, de la part de marchands peu scrupuleux, une transformation pour laquelle l’appât du lucre n’est pas étranger. C’est aussi l’occasion pour Cazin de remettre en cause cette idée reçue, particulièrement tenace puisqu’elle existe toujours en ce début de XXI ème siècle, que ce qui est exotique est plus efficace ; et, en travaillant avec des produits locaux, à portée de mains, il démontre l’inanité de ce jugement et prouve avec aisance que l’herbe n’est pas forcément plus verte chez le voisin. Il n’en va pas que de la qualité d’une plante, il en va aussi de celle de celui qui l’emploie. Et si manque le bon sens, qu’un végétal soit exotique ou indigène, il n’est rien qui soit possible de faire, l’échec thérapeutique ne saurait être que patent. Il est assez facile de jeter l’opprobre sur les plantes locales en les regardant de haut, lorsqu’on a toujours connu ces préparations médicamenteuses, embouteillées et étiquetées, flambantes neuves, sur les étagères du pharmacien, chose que Cazin finira par rejeter, insistant sur les étapes préalables et incontournables d’une bonne pratique phytothérapeutique : maîtriser la botanique médicale (!!!), récolter des plantes sauvages de préférence au moment opportun, les faire sécher correctement si cela s’avère nécessaire ou bien en faire un usage immédiat. Oui ! Qui imaginerait faire une soupe avec une botte de poireaux ayant jauni au réfrigérateur ou à la cave ? Soyons sérieux.
C’est cette fraîcheur et cette instantanéité que le docteur Cazin a placées en exergue durant toutes ses années passées comme médecin de campagne avec, sous la main, foison de remèdes végétaux que l’on retrouve dans son monumental ouvrage, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes. Cette somme, rééditée et augmentée en 1858, présente en 1200 pages environ 500 plantes, accompagnée de 40 planches botaniques dessinées par le fils de François-Joseph, Henri Cazin (1836-1891), également médecin et artiste peintre.
- Toutes les citations placées entre guillemets sont extraites de la préface du Traité pratique et raisonné.
© Books of Dante – 2017